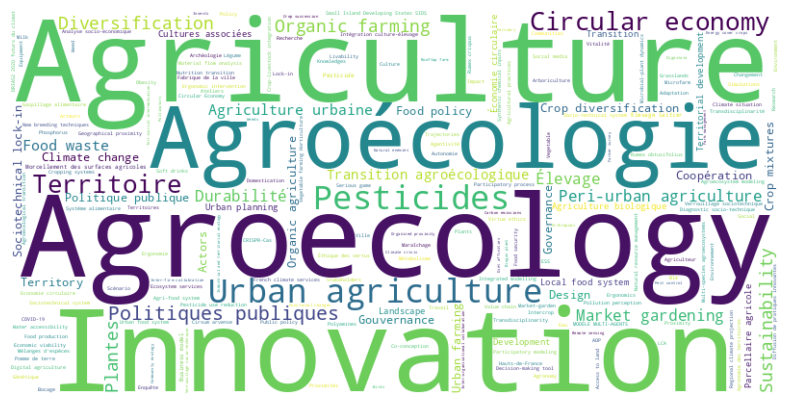-
[hal-05485752] Beyond pesticide reduction: Exploring synergies between contrasted territorial scenarios
Pesticide use creates significant environmental, health and socioeconomic challenges and its reduction is hindered by sociotechnical lock-ins. The territorial level, combined with systemic approaches, is promising to overcome these systemic challenges. This research proposes an original methodological approach which, instead of aiming at creating consensus, explores contrasted pesticide reduction scenarios with local stakeholders based on existing initiatives in order to identify pathways for collective action. The study was conducted in the Western Plain of Montpellier, in Southern France, and involved a diversity of stakeholders from the territory and outside of the territory in 5 steps, using the Co-Click’Eau tool and workshops. The scenarios explored the potential of diversification for food production, biodiversity conservation and crop-livestock integration to meet pesticide reduction challenges. In addition to an important pesticide use reduction, each scenario proposed significant land-use and farming practices transformations. The analysis revealed that the approach was able to create spaces for dialogue through the formulation of synergies between these strategies by participants, especially on land-use management, technical levers, linking production to consumers and highlighted complementary contributions of biodiversity and livestock to the territory. Beyond its agronomic dimensions, the process opens the pathway to better coordination with the identification of synergies and tensions between different visions, helping to identify coherent strategies including agricultural production, biodiversity, and food objectives. By doing so, our approach contributes to embedding pesticide reduction into a broader, systemic reconfiguration of agroecosystems and territorial governance.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Myrto Parmantier) 30 Jan 2026
https://hal.science/hal-05485752v1
-
[hal-05242682] Generic crop rotation pattern-matching algorithm revealed dominant rotational systems for France
Crop rotations remain poorly documented at large spatial scale, despite their central role in agroecosystem sustainability. We present a generic pattern-matching algorithm to infer crop rotations from annual crop sequence datasets, such as those derived from the European Land Parcel Identification System, with minimal crop aggregation. This method identifies field-level rotations, quantifies their flexibility, and enables spatially-explicit assessment of dominant crop and grasslands rotational systems at various spatial and thematic levels. Applied to mainland France, the approach identified crop rotations on 90% of arable area, with four-year rotations -typically including two to three years of flexible crops-being the most common. Nationally, the top 20 rotations accounted for 30% of arable land, while the top 52 covered 50%. At the agricultural district scale, we distinguished 25 dominant rotational systems grouped into eight categories, including (i) maize grain monocropping, (ii) maize grain -winter wheat rotations, (iii) sunflower -winter wheat rotations, (iv) grass-based systems, (v) maize silage -winter wheat rotations, (vi) winter wheat -barley -rapeseed rotations, (vii) root crop-based rotations, and (viii) specialized production. At national scale, organic rotations were longer and more flexible than conventional ones. Rotations of larger farms were longer and temporally more diverse than smaller ones, but showed lower spatial diversity. This scalable, data-driven approach offers new insights into crop rotation patterns and their spatial variability. It can support the large-scale assessment of agroecosystems with quantitative evidences on dominant rotations, but also help at tracking and characterizing localized rotational innovations.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Ugo Javourez) 21 Jan 2026
https://hal.science/hal-05242682v2
-
[hal-05514152] Genetic diversity in Morocco’ sunflower “Helianthus annuus L.” gene-bank for autumn-early winter plantation conditions: Agro-morpho-physiological screening
Despite Morocco's reliance on sunflower as an oilseed crop, little is known about its agronomic performance when sown in autumn or early winter. This knowledge gap is critical, as spring-sown varieties have shown declining performance in recent years under intensifying climate stress. Therefore, targeted breeding strategies could discover genotypes suitable for autumn or early winter sowing, with cold tolerance as a key selection criterion. Currently, ‘Ichraq’ is the only autumn-planted sunflower variety officially registered in Morocco, although efforts to release additional tolerant varieties are underway. This study evaluated 31 genotypes (MGB1 to MGB31) selected from various environments under autumn planting conditions and conserved in the Moroccan Gene Bank. These genotypes were planted in early winter at a mountainous site known for its pronounced winter cold. Eighteen Morphological, physiological and agronomic parameters including initial vigor, leaf area, seed yield, oil content etc., were assessed using both univariate and multivariate statistical approaches. Analysis of variance revealed significant genotypic differences across most traits, indicating substantial genetic variation. Notably, seed oil content ranged from 23.28% (MGB26) to 43.88% (MGB5), and seed yield from 1400 kg/ha (MGB7) to 5400 kg/ha (MGB8). Principal component analysis (PCA) identified that the first principal component, accounting for over 24% of the total phenotypic variance, exhibits a strong positive loading of yield-related traits and chlorophyll content, while displaying a pronounced negative loading for oil content variables. This opposing gradient indicates a clear trade-off between vegetative productivity and oil accumulation across the evaluated genotypes. Hierarchical cluster analysis resolved the germplasm into two principal clusters with high within-group similarity, each further partitioned into relatively homogeneous subgroups. Notably, several genotypes outperformed the control variety Ichraq, underscoring their potential for autumn or early winter cultivation. Nonetheless, essential multi-environment trials remain to validate their phenotypic stability and to ascertain their value as genetic resources for sunflower breeding programs in Morocco and other Mediterranean agro-ecosystems.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Karim Houmanat) 17 Feb 2026
https://hal.inrae.fr/hal-05514152v1
-
[hal-05488887] Revealing the diversity of collective experimentation in agriculture: Constructing idealtypes from French case studies
Context: The agroecological transition underscores the need to rethink knowledge production in agriculture, especially in relation to experimentation. This includes involving a wider range of stakeholders and exploring diverse and complementary forms of experimentation. Objective: This article aims to shed light on the diversity of existing collective experimentations, in order to document the ongoing renewal of experimental approaches and to propose benchmarks for understanding and supporting them. Methods: We conducted 34 semi-structured interviews and 10 observant participations, leading to the identification of 28 case studies that we define as collective experimentations. We define collective experimentation as the process of implementing and monitoring an intervention with uncertain outcomes, which leads to the production of knowledge. We did a comprehensive analysis of these collective experimentations, to understand how and why they are conducted. To do so, our analysis considered both the physical design of the experimental setups and the questions addressed, as well as the collective organization of the actors involved. Results and Conclusions: We propose six idealtypes of collective experimentations: Idealtype A: Replicating experimental situations to generate standardized data, Idealtype B: Integrating data from diverse experimental practices in a joint analysis, Idealtype C: Distributing questions to generate knowledge on a common topic, Idealtype D: Pooling a diversity of experiences to explore a common subject, Idealtype E: Distributing activities within a single experimental situation and Idealtype F: Gathering human and material resources on a single site to experiment jointly on several experimental situations. Significance: These idealtypes shed light on the diversity of collective experimentation approaches in agriculture, which are often under described in the literature. By offering a set of structured reference points, it can support researchers, facilitators, and practitioners in recognizing, designing and valuing collective experimentations adapted to their contexts. It opens new perspectives for rethinking how experimental knowledge is produced, shared, and valued to support agroecological transitions.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Maïté de Sainte Agathe) 02 Feb 2026
https://hal.inrae.fr/hal-05488887v1
-
[hal-05508527] Challenges facing agricultural cooperatives in Mediterranean countries
Agricultural cooperatives are vital to the Mediterranean region, enhancing farmers' market access, bargaining power, and innovation. However, they face significant challenges threatening their sustainability. This paper examines these challenges in France, Greece, Italy, Spain, and T & uuml;rkiye using a qualitative approach that integrates insights from Solution Hub discussions and interviews with cooperative leaders, experts, and policymakers. It identifies common challenges-governance inefficiencies, financial instability, climate change impacts, and generational renewal-alongside country-specific obstacles shaped by distinct socio-economic, environmental, and political contexts. Governance inefficiencies, including slow decision-making and underrepresentation of women and youth, are pervasive but manifest differently across countries. Financial instability, driven by market volatility and limited credit access, is particularly acute in Greece and T & uuml;rkiye. Climate change poses serious threats, with France focusing on decarbonization and agro-ecological transitions, while Greece and T & uuml;rkiye grapple with water scarcity and extreme weather. Demographic shifts, including rural depopulation and an aging workforce, exacerbate these challenges, especially in Italy and Spain. This study contributes to the literature by providing a comparative analysis of Mediterranean agricultural cooperatives, addressing a gap in research that often focuses on single-country studies. It underscores the need for context-specific strategies, recognizing that while some challenges are shared, their intensity and manifestations vary. The findings highlight the crucial role of cooperatives in addressing climate change and rural depopulation-areas often overlooked in the literature. Practical implications include targeted interventions, capacity-building, and supportive legal frameworks to enhance cooperative resilience. By fostering innovation, inclusivity, and regional collaboration, stakeholders can strengthen these essential institutions.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Constantine Iliopoulos) 13 Feb 2026
https://hal.inrae.fr/hal-05508527v1
-
[hal-05507806] Do skewed sex ratios reduce son preference?
[...]
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Matthieu Clément) 12 Feb 2026
https://hal.science/hal-05507806v1
-
[hal-05489016] What shapes a livable city? Subjective and objective determinants of city satisfaction in Romania
This article examines urban quality of life in 41 Romanian cities by combining survey evidence from the 2020 Urban Barometer (N = 13,380) with a spatially detailed Quality of Life Index (QOLI) derived from OpenStreetMap and census data. Using hierarchical logistic regression, we assess how individual perceptions and city-level conditions shape city satisfaction. Results show that facilities and services, environmental quality, and governance contribute positively to satisfaction, while perceptions of trust and safety are among the strongest predictors. In contrast, the QOLI measuring the objective availability of amenities is negatively associated with satisfaction, indicating that infrastructure provision alone does not ensure well-being. City size is positively related to satisfaction, whereas economic indicators such as unemployment and aggregate turnover per population have little explanatory power. The study shows that urban well-being depends less on material provision and more on governance, trust, and residents' expectations, with implications for cities in Central and Eastern Europe where historical legacies and uneven development continue to shape urban experiences.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Norbert Petrovici) 02 Feb 2026
https://hal.inrae.fr/hal-05489016v1
-
[hal-05485748] Potential of local collective action to reduce pesticide use in a French Mediterranean landscape
Pesticide use in agriculture has significant negative impacts on human health, ecosystems, and natural resources. The failure to meet targets for pesticide reduction at the farm level underscores the need for a systemic, holistic approach that considers the diversity of actors and the complexity of the farming systems involved. The landscape level provides a relevant framework for addressing the reduction of pesticide use and impacts. In this study, we analyzed 19 initiatives aimed to reduce pesticide use or its impacts in agriculture in a Mediterranean peri-urban plain in southern France. Drawing on insights from landscape agronomy and research on collective action, we developed a novel conceptual framework to capture and analyze the diversity and complementarity of local dynamics of pesticide reduction. Through interviews, workshops, and farm surveys, we examined the factors driving the emergence of these initiatives and assessed their anticipated impacts on farming practices, landscape patterns, and natural resources at the landscape level. The results revealed that these initiatives were led by diverse, and sometimes conflicting, strategies to reduce pesticide use that focused mainly on optimizing pesticide use in dominant agricultural systems, alongside farm reconfiguration and biodiversity integration strategies. This study advances current knowledge by providing actionable insights to improve collective action at the landscape level, such as spaces for synergies for landscape-level coordination and identified barriers to this coordination. Our findings emphasize the importance of embracing complexity when designing and implementing pesticide-reduction strategies.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Myrto Parmantier) 30 Jan 2026
https://hal.science/hal-05485748v1
-
[hal-05514769] The Territorial Circular Ecosystem: Foundations for a Systemic and Place-Based Approach to Circular Economy
This article introduces the concept of the Territorial Circular Ecosystem (TCE) as a framework to understand the conditions that support the deployment of circular economy principles at the local level. It draws on the legacy of local production systems, from Marshallian districts to more recent approaches such as green clusters and industrial symbioses. These models have contributed to the ecological transition of economic systems but continue to show important limitations regarding for example the coordination of actors, the integration of stakeholders, and the implementation of circular strategies based on the 10R. The TCE framework defines a set of components and relational mechanisms rooted in territorial dynamics. It places emphasis on various types of local cooperation, geographical and organized proximities, institutional support, and societal involvement. This contribution establishes a conceptual foundation for the analysis of local circular systems and provides useful orientations for public policy and future empirical research.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (André Torre) 17 Feb 2026
https://hal.inrae.fr/hal-05514769v1
-
[hal-05477011] Concilier fertilité, autonomie et travail en maraîchage biologique : expérimentation de systèmes de cultures innovants -projet PERSYST
Nous avons évalué pendant 4 ans des systèmes de culture innovants en maraîchage biologique dans l'Ouest de la France combinant différentes modalités de réduction de travail du sol et d'apports de matières végétales exogènes en complément de couverts végétaux. Nos résultats suggèrent que des apports végétaux exogènes peuvent se substituer aux engrais organiques du commerce ou aux fertilisants d'origine animale pour maintenir ou améliorer la fertilité des sols et assurer des rendements identiques mais peuvent impacter négativement les conditions de travail, en particulier sans équipement adapté. Le travail du sol limité (sans labour) n'a pas d'impact significatif sur la fertilité, le rendement ou le travail. Le travail du sol très limité a des impacts contrastés en fonction des contextes et des conditions initiales.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Kevin Morel) 26 Jan 2026
https://hal.inrae.fr/hal-05477011v1
-
[hal-05502364] Quel numérique pour l'agroécologie ? Enseignements de la co-conception de la Pépinière-Mesclun, une application en ligne pour les maraîchers
A travers l'analyse d'un cas d'étude de co-conception d'une application en ligne pour les maraîchers (La Pépinière-Mesclun) notre objectif était d'explorer les caractéristiques d'un outil numérique pouvant répondre aux besoins et aux attentes d'usagers engagés dans des démarches d'agroécologie. Nous avons identifié 73 décisions de design prises au cours du processus qui se rattachent à 13 principes de design et 4 valeurs de design. En termes de valeurs, notre outil devait (i) respecter la diversité et la complexité des systèmes agricoles, (ii) être accessible à une diversité des profils d'usagers, (iii) valoriser l'expertise humaine et soutenir l'autonomie de décision, (iv) être géré comme un « commun numérique ».
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Kevin Morel) 10 Feb 2026
https://hal.inrae.fr/hal-05502364v1
-
[hal-05488573] Becoming the Workplace Change (BeWorC): a model for intervention built on hybridisation of the change Laboratory and activity-centered ergonomics
This research explores the interaction among transformational leadership, human-technology interaction (HTI) and sustainable practice, specifically examining the integration of safeguard systems, the Internet of Things (IoT) and cyber-physical systems (CPS) to improve leadership and sustainability. Using survey data from 200 respondents in Indonesia’s upstream oil and gas industry, this study applies SEM and Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis (FsQCA) to analyse the correlation between HTI and sustainable practices. The findings of this study indicate that the integration of safeguard systems, while having a minimal effect on human-technology interaction (HTI), enhances security and aligns with the evolving technological landscape shaped by CPS and the IoT. However, its influence on sustainable practices is contingent upon transformational leadership, which serves as a critical driver in guiding organisations towards the adoption of innovative solutions while ensuring the achievement of long-term sustainability objectives. Furthermore, the results support the theoretical rationale for incorporating these factors and underscore the analytical robustness of FsQCA. This methodological approach consistently identifies the convergence of key variables as fundamental enablers of sustainable outcomes within the Indonesian oil and gas sector, emphasising the necessity of understanding these complex interrelationships.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Vivian Aline Mininel) 02 Feb 2026
https://hal.inrae.fr/hal-05488573v1
-
[tel-05520840] Le rôle des réseaux multiplex dans les processus d'innovation : Le cas de l'industrie semencière chinoise
Derrière les résultats de l'innovation se cachent des réseaux complexes intégrés dans divers territoires. Si les géographes économiques ont examiné les dimensions multi-échelles de ces réseaux, la nature non linéaire et spatiale de l'innovation, qui implique divers acteurs reliés par de multiples types de relations, reste sous-théorisée. En outre, ces dynamiques sont sous-étudiées dans le secteur agricole critique. Cette thèse de doctorat comble ces lacunes en développant et en appliquant un cadre de réseau multiplex pour analyser comment les échelles et les structures des réseaux façonnent les processus et les résultats de l'innovation. Le cas de l'industrie semencière chinoise, composante stratégique de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale, est à l'étude.La thèse offre une revue exhaustive des études sur l'innovation dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Elle contribue à améliorer notre compréhension des activités d'innovation qui ont retenu l'attention, de la manière dont des chercheurs issus de diverses disciplines ont abordé ce sujet et des raisons pour lesquelles il est essentiel de mieux comprendre les processus d'innovation dans l'agriculture. Elle présente ensuite trois études empiriques : l'une examine le secteur national des semences de tomates, tandis que les deux autres se concentrent sur l'industrie locale des semences potagères. Collectivement, ces études apportent une triple contribution. Sur le plan théorique, elles démontrent la nécessité d'intégrer une perspective non linéaire et multiplexe dans la compréhension des processus et des résultats de l'innovation par la géographie économique. Sur le plan méthodologique, elles font progresser l'application de l'analyse des réseaux multiplexes à l'innovation non linéaire. Sur le plan empirique, elles fournissent un examen approfondi et rare des dynamiques relationnelles qui stimulent l'innovation et relient l'industrie mondiale des semences aux clusters locaux. Au niveau politique, la thèse offre des perspectives concrètes pour promouvoir l'innovation et le développement au sein de l'industrie semencière nationale et dans le contexte des pôles agricoles.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Qiang Cao) 20 Feb 2026
https://pastel.hal.science/tel-05520840v1
-
[hal-05507035] A Simple Test for Supermodular Dominance
[...]
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (M’hand Fares) 12 Feb 2026
https://hal.science/hal-05507035v1
-
[hal-05031252] Concilier fertilité, autonomie et travail en maraîchage biologique : expérimentation de systèmes de cultures innovants dans le projet PERSYST
Cet article est la version longue et détaillée d'un texte soumis à la revue Innovations Agronomiques et qui fera également l'objet d'une publication dans une revue internationale. Nous avons évalué pendant 4 ans des systèmes de culture innovants en maraîchage biologique dans l'Ouest de la France combinant différentes modalités de réduction de travail du sol et d'apports de matières végétales exogènes en complément de couverts végétaux. Nos résultats suggèrent que des apports végétaux exogènes peuvent se substituer aux engrais organiques du commerce ou aux fertilisants d'origine animale pour maintenir ou améliorer la fertilité des sols et assurer des rendements identiques mais peuvent impacter négativement le travail, en particulier sans équipement adapté. Le travail du sol limité (sans labour) n'a pas d'impact significatif sur la fertilité, le rendement ou le travail. Le travail du sol très limité a des impacts contrastés en fonction des contextes et des conditions initiales.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Kevin Morel) 15 Dec 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05031252v3
-
[hal-05496050] L'agriculture française ne permet pas en l'état actuel de produire des régimes suffisamment durables pour la santé et l’environnement : une analyse des conflits entre souveraineté et durabilité alimentaire par optimisation multicritères des régimes
Introduction et but de l’étude : Afin d’atteindre des systèmes alimentaires plus durables, il est essentiel de comprendre comment réorienter nos productions agricoles et nos consommations alimentaires en considérant plusieurs critères : le risque de maladies chroniques et les pressions environnementales, mais aussi la capacité d'autosuffisance de nos productions agricoles. Si ces réorientations devront concerner à la fois nos productions et nos consommations, il est important d’explorer dans un premier temps les changements de consommation souhaitables sur la base de notre production agricole actuelle, afin de comprendre ce qu'il est possible d'atteindre par ce seul levier. Par une approche d’optimisation multicritères des régimes alimentaires français, nous avons analysé les conflits et réalignements possibles entre les critères d’autosuffisance, de santé et de pressions environnementales. Matériel et méthodes : A partir des régimes alimentaires observés dans l’enquête représentative française INCA3, et des caractéristiques nutritionnelles (CIQUAL), de santé (Global Burden of Disease Study), environnementales (Agribalyse) et d’autosuffisance (FAOSTAT et base de données nationales) des groupes alimentaires composant ces régimes, nous avons simulé des changements de consommation visant à renforcer l’autosuffisance et/ou la durabilité des régimes alimentaires en termes de santé humaine et planétaire. Ces régimes ont été modélisés par optimisation multicritère, pour explorer le front de Pareto des conflits et compromis possibles entre maximiser l’autosuffisance (c.à.d., minimiser les importations) et minimiser soit le risque de maladies chroniques, soit les émissions de gaz à effet de serre (GES). L’ensemble des scénarios modélisés respectaient des contraintes d’adéquation nutritionnelle et d’acceptabilité culturelle des régimes. Résultats et analyses statistiques : En modifiant uniquement nos régimes alimentaires, tout en restant à production agricole constante, il est possible de diminuer jusqu’à 50% nos volumes d’importation – en réduisant en parallèle de 25% nos volumes d’exportation, puisque les régimes optimisés comprennent davantage d’aliments produits en grande quantité et initialement destinés à l’export. Concernant la dimension santé, ce repositionnement s’accompagne d’une réduction de 30% du risque de maladies chroniques. Cependant, toute réduction supplémentaire de ce risque santé entraînerait une augmentation générale des volumes d’importation, jusqu’à revenir aux niveaux actuels pour une réduction de 95% du risque santé, voire augmenter de 30% les volumes d’importation totaux pour l’annulation du risque santé. Concernant la dimension environnementale, il est aussi possible de réduire de 50% nos volumes d’importation, en parallèle d’une diminution de 50% des émissions de GES des régimes. Cependant, diminuer davantage les émissions de GES entraînerait une augmentation des volumes d’importation allant jusqu’à leur doublement pour une réduction ambitieuse du risque climatique. Dans tous les scénarios, l’amélioration de l’autosuffisance et de la durabilité santé et environnementale des régimes alimentaires entraîne une réduction de 50% de la consommation des viandes (viande, poisson, œuf), comprenant l’exclusion de la viande rouge et de la viande transformée, ainsi qu’une augmentation de la consommation des céréales complètes, légumineuses, noix et fruits. Selon les scénarios privilégiés (réduction du risque santé ou des émissions de GES), les contributions de certains groupes alimentaires tels que le lait ou les légumes varient. Conclusion : Il est possible d’aller vers des régimes alimentaires plus durables et plus autosuffisants en réorientant nos consommations vers des aliments favorables à la santé et l’environnement et déjà produits en grandes quantités en France. Les gains de durabilité possibles par ce biais sont cependant limités et insuffisants, notamment si nous voulons améliorer notre autosuffisance. Une réorientation de notre production agricole est donc nécessaire pour des systèmes alimentaires plus durables et autosuffisants. Les perspectives sont de réexaminer les compromis entre autosuffisance et durabilité, en unifiant les dimensions santé et environnement, afin d’identifier des régimes alimentaires cibles prometteurs et de simuler comment des évolutions de la production pourraient renforcer la souveraineté alimentaire.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Marianne Cerf) 05 Feb 2026
https://hal.science/hal-05496050v1
-
[hal-05398223] Comparison of two contrasted approaches of participatory design: lessons from designing tools for the sustainability assessment of urban agriculture projects
How to involve end-users in the design of tools has been a major issue in design sciences for decades. This article explores the case of sustainability assessment tool design in the intra-urban agricultural sector. Today, professional intra-urban agriculture (PIUA) projects are developing exponentially in Northern countries, taking a variety of forms such as greenhouses on rooftops, indoor mushroom farms, or educational farms inside schools. PIUA stakeholders need to assess their sustainability, but this innovative form of agriculture requires specific tools. This article is dedicated to the participatory design of sustainability assessment tools adapted to PIUA. Users’ participation can take different forms; for this reason, we compare two participatory design approaches to explore whether and how they take account of users’ realities. To do so, we built a specific analytical framework based on the comparison of the design processes, the concepts and knowledge generated, and the tools designed. In the first approach, French PIUA stakeholders are involved through interviews and surveys to validate the content of the tool. In the second approach, French PIUA stakeholders, including some of the participants in the first approach, are involved through a diagnosis of uses and innovative design workshops. Our results highlight that the diagnosis of uses, which gives access to users’ practices, is a key element to lead to innovative results. Tool designers should choose a design approach depending on the type of system being studied, the resources available, and the objectives set beforehand.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Paola Clerino) 04 Dec 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05398223v1
-
[hal-05502016] Révéler la diversité de l'expérimentation collective en agriculture
L'expérimentation agronomique est un mode de production de connaissance qui est aujourd'hui porté par la recherche mais aussi par des collectifs réunissant agriculteurs, conseillers ou animateurs. Bien que ces expérimentations collectives soient courantes, elles restent encore peu documentées. Cet article en recense 28 cas agricoles français pour donner à voir la diversité des pratiques et objectifs qui y sont associés. L'analyse aboutit à six idéaltypes, pensés pour servir de repères et permettent aux chercheurs, praticiens ou animateurs de mieux reconnaître, concevoir et valoriser des expérimentations adaptées à leurs contextes, contribuant ainsi au renouvellement des façons de produire et partager des connaissances.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Maïté de Sainte Agathe) 10 Feb 2026
https://hal.inrae.fr/hal-05502016v1
-
[hal-05404868] Caractérisation des systèmes de culture associés à la méthanisation sans élevage et évaluation de leurs performances agro-environnementales sous différents scénarios climatiques
[...]
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Léa Boros) 08 Dec 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05404868v1
-
[hal-05421062] Adoption of mobile-based agricultural extension services: evidence from South India
[...]
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Marija Cerjak) 17 Dec 2025
https://hal.science/hal-05421062v1
-
[tel-05456637] Caractérisation des systèmes de culture associés à la méthanisation sans élevage et évaluation de leurs performances agro-environnementales sous différents scénarios climatiques
La méthanisation est en fort développement en Europe, particulièrement en France où se déploie notamment la méthanisation sans élevage. Celle-ci repose sur le recours aux cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) et aux intrants agro-industriels. Les CIVE sont promues pour leurs divers bénéfices (couverture des sols, stockage de carbone…). Cependant, leur usage soulève des inquiétudes, notamment en termes de besoins en eau et en nutriments ou encore de pertes de rendement sur les cultures principales. Malgré ces enjeux, les systèmes de culture associés à la méthanisation sans élevage restent peu documentés dans leurs conditions réelles de déploiement et sont donc mal considérés dans les évaluations environnementales de la méthanisation. Par ailleurs, l'impact du changement climatique sur ces systèmes reste encore peu été étudié.Cette thèse vise à combler ces lacunes à travers deux objectifs : 1) caractériser les systèmes de culture mis en œuvre avec méthanisation sans élevage et les logiques de changements d'assolement associées ; 2) évaluer leurs performances agro-environnementales selon divers scénarios climatiques.Trois approches ont été mobilisées. Premièrement, une analyse croisée de bases de données cartographiques a permis d'identifier, à l'échelle nationale, les changements d'assolement associés à l'installation de méthaniseurs. En moyenne, une diminution du blé et du colza a été observée, au profit du maïs et d'autres céréales (seigle, triticale, sorgho, …), ainsi qu'une stabilité des surfaces en « fourrages et prairies », avec des dynamiques spécifiques selon les régions. Les changements étaient plus marqués dans les exploitations en grandes cultures et associées à des méthaniseurs en injection. Deuxièmement, des enquêtes ont été menées auprès d'agriculteurs méthaniseurs sans élevage dans le bassin parisien. Elles ont permis de documenter et de comprendre les systèmes de culture mis en œuvre. Les CIVE occupaient en moyenne chaque année 30% de la SAU, grâce à une diminution des soles en blé et colza au profit de l'orge, du seigle, du maïs et du sorgho (cultures principales et/ou CIVE). Les CIVE étaient conduites de façon à maximiser leur biomasse (usage majoritaire de pesticides, irrigation des CIVE d'été sur une ferme sur deux, fertilisation, récolte tardive des CIVE d'hiver amenant des pertes de rendement fréquentes sur la culture principale). Par ailleurs, le digestat était épandu majoritairement en sortie d'hiver sur céréales (CIVE ou non). Les économies d'engrais étaient variables d'une ferme à l'autre et dépendantes de la quantité d'intrants agro-industriels méthanisés. Enfin, une modélisation des performances agro-environnementales de ces systèmes a été réalisée via les modèles PROLEG et SysMetha, selon deux scénarios de changement climatique et trois modèles climatiques, le tout en s'appuyant sur les pratiques observées sur le terrain. Les résultats ont montré une amélioration du bilan GES, une augmentation du stockage de carbone dans les sols et une diminution de l'utilisation d'engrais de synthèse, mais une augmentation des pertes azotées par volatilisation et sous forme de N2O, ainsi qu'une réduction de la lame drainante et de la production alimentaire. Le changement climatique, quant à lui, tend à réduire le stockage de carbone et les rendements, ainsi qu'à augmenter le bilan GES, aussi bien dans les cas avec et sans méthanisation.Ainsi, si la méthanisation sans élevage constitue un levier pertinent pour la transition énergétique, sa mise en œuvre doit s'accompagner d'une gestion des systèmes culturaux limitant les impacts négatifs et garantissant une durabilité agronomique et environnementale.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Léa Boros) 13 Jan 2026
https://pastel.hal.science/tel-05456637v1
-
[hal-05430986] Analyse des successions culturales 2015 -2022 en France : état des lieux du niveau de diversification en agriculture conventionnelle et biologique
L'allongement et la diversification des rotations sont des leviers majeurs pour réduire le recours aux produits phytosanitaires et engrais de synthèse. Face à ces enjeux, il est nécessaire d'acquérir des connaissances sur les successions culturales à échelle géographique fine. A partir des données de séquences de cultures issues du Registre Parcellaire Graphique, et du travail d'un groupe d'experts en agronomie, l'Observatoire du Développement Rural a précédemment produit un jeu d'indicateurs qualifiant les successions sur terres arables, sur la période 2015-2021. Une nouvelle version de ces indicateurs, portant sur 2015-2022, est à présent disponible. Les résultats distinguent désormais les successions en agriculture biologique et conventionnelle. En moyenne, 3.7 cultures sont enregistrées sur 8 années de succession. Les successions sont plus diversifiées en agriculture biologique et comportent beaucoup plus fréquemment des légumineuses. Sur les quatre dernières années de la période, près de 90 % des surfaces ont eu au moins deux cultures différentes, ce qui correspond à la nouvelle norme relative aux rotations introduite dans la PAC 2023-2027.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Marie-Sophie Dedieu) 24 Dec 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05430986v1
-
[hal-05376337] What is the nature of evidence regarding relationships between urban agriculture and gentrification? A systematic map protocol
As people work towards environmental sustainability for urban environments and everyday lives, tensions have been seen in different efforts on food, housing, environmental management, urban planning, and many cross-cutting issues touching on multiple aspects of social-ecological systems. Urban agriculture (UA) as one multifaceted, cross-cutting arena, has had one particular tension regarding relationships with housing and the built environment: its gentrification potential. However, different accounts have provided evidence and theorization of gentrification as a possible outcome of UA activities, as a risk for UA initiatives, and showing still other relationships between UA and gentrification. These different accounts may be partially explained by different theoretical engagements with gentrification, as well as multiple activities constituting a broad notion of urban agriculture. An overview of the scholarly work regarding these two topics can provide a starting point for understanding how they have been approached and theoretically engaged together, and demonstrate gaps in dominant academic discourses. Methods This research for a systematic mapping of literature seeks to assess the academic work around relationships between urban agriculture and gentrification. The protocol outlines a comprehensive and reliable search and review strategy based on the core components of urban, agriculture, and gentrification in search strings and inclusion criteria. Texts in English, French, and German will be scanned as historically and currently dominant academic languages, while searching nine bibliographic databases or platforms. The protocol details a data coding strategy for metadata, empirical content, and analytic content. The results are expected to uncover sources of evidence for links between urban agriculture and gentrification, producing interoperable datasets of the evidence base, insights of the overall research landscape, and possibilities to find research gaps.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Anton Parisi) 25 Nov 2025
https://hal.science/hal-05376337v1
-
[hal-05384974] L’installation en élevage en France : enjeux et agenda de recherche
L’installation en élevage est une problématique clé du monde agricole avec une forte diminution du nombre d’élevages en France comme en Europe. Or les processus d’installation en élevage et les porteurs des projets sont de plus en plus diversifiés. Une compréhension des processus et des porteurs est nécessaire pour que les acteurs de l’accompagnement, à caractériser eux aussi, puissent développer les outils et méthodes pertinents. Ce travail s’est appuyé sur trois corpus : des entretiens auprès d’experts de l’installation et de l’élevage, une littérature grise abondante et une littérature scientifique sans aspect prospectif. L’état des lieux confirme les complexités grandissantes caractérisant les processus d’installation, les porteurs de projet, les projets eux-mêmes et les socio-écosystèmes territorialisés dans lesquels ces processus se déroulent. Leviers et freins sont proposés notamment sur la constitution des moyens de production : collectif de travail, foncier ou bâtiments, équipements et cheptels, où la tendance est à l’atténuation des spécificités du secteur et à l’hybridation avec d’autres ressources. Les dispositifs d’accompagnement et les acteurs associés sont présentés, soulignant la diversité de ceux-ci tant dans leurs rôles que dans leurs postures. Trois grandes questions sont proposées dans une approche transdisciplinaire de recherche pour l’action afin d’accompagner l’installation en élevage dans une période de transitions multiples majeures.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Marie-Odile Nozières-Petit) 27 Nov 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05384974v1
-
[hal-05393521] Collaborations de recherche entre génétique végétale et agronomie : une approche diachronique pour appréhender leurs enjeux actuels et leur renouvellement
[...]
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Alice Dupré La Tour) 29 Jan 2026
https://hal.inrae.fr/hal-05393521v1
-
[hal-05376302] Social–ecological approach to analyse systemic changes toward agroecological practices in vineyards under geographical indications: A case study of ground cover management in the Anjou-Saumur wine area (France)
Agroecology offers solutions to viticulture challenges, including climate adaptation, reducing phytosanitary product use, and preserving biodiversity and soil quality. In France, where most viticultural production is under geographical indications, strict product specifications regulate practices. Although agricultural policies continue to encourage changes in practices, the question arises as to how to encourage these changes in the context of winegrowing under protected designations of origin. This study contributes to research on viticultural agroecology with a new analytical approach to studying viticultural practices at the farm level by adapting the social–ecological system framework (SES). We conceptualise the viticultural agroecosystem as an agroecological resource system where viticultural practices are considered as interactions between winegrowers and their agroecosystems. Using a mixed-method approach, we analysed data from 34 semi-structured interviews with winegrowers in the Anjou-Saumur region of France. Our findings are twofold. First, by classifying winegrowers based on ground cover management, we reveal diverse transition pathways toward zero-herbicide viticulture, linked to environmental certifications such as Organic Agriculture, High Environmental Value, or Terra Vitis. Second, we highlight that many winegrowers consider several agroecological issues when choosing their practices. This approach provides a nuanced understanding of agro-viticultural practices, incorporating both productive and non-productive zones across small territories. Our results also allow for a better understanding of the agroecological transition by identifying the differences in individual reasoning within a collective associated with protected designations of origin.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Faustine Ruggieri) 21 Nov 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05376302v1
-
[hal-05361991] Retours à/de la Terre : Vues d'Europe et du Japon
Envisageant la Terre, tantôt vulnérable, tantôt menaçante, cet ouvrage invite à prendre conscience de la finitude du monde. Face aux multiples crises écologiques ou technologiques, on peut décider de retourner à la terre, mais on ne choisit pas le retour de la Terre. Excluant tout fatalisme, le livre explore les aspirations contemporaines à renouer avec notre matrice commune ou nouveau bien commun en Europe et au Japon. La comparaison internationale met en relief la circulation des idées et des initiatives et invite à repenser les manières de faire corps avec les milieux de vie. À travers une approche pluridisciplinaire en géographie, sociologie, philosophie et économie les auteurs croisent les regards et expériences pour éclairer une triple conception de la Terre : territoire de vie, sol nourricier et milieu partagé.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Nicolas Baumert) 17 Nov 2025
https://hal.science/hal-05361991v1
-
[hal-05404916] Anaerobic digestion in French cereal farms using energy cover crops: evaluating agro-environmental performance in real-case systems across climate scenarios
[...]
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Léa Boros) 08 Dec 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05404916v1
-
[hal-05273505] Climate change and irrigation management shape crop resilience in UAE arid agriculture: APSIM model-driven assessment
Climate change has intensified challenges to food security, compelling the United Arab Emirates (UAE) government to allocate significant resources and advanced technologies for assessing cropping systems performances across country. Crop modeling has emerged as cutting-edge tools for analyzing crop management and assessing water-soil resources usage and sustainability. This study applied a process-based crop model to evaluate performances of three annual crops—wheat, maize, and potato— under integrated climate change projections and irrigation management strategies within the UAE's arid agroecosystems. APSIM-model was used to simulate crop eco-physiological responses, and assess their vulnerability–resilience profiles under combined climate-water stressors. Model calibration-validation processes were conducted using dataset encompassing crop phenological and productivity state variables. Time-series simulations were then performed under baseline-historical and future-projected period (1988–2100) defined by four Shared-Socioeconomic-Pathways (SSPs: 2.6–4.5–7.0–8.5). Results show that APSIM-model was successfully calibrated, and model validation further confirmed its robust accuracy in simulating crops development and yield prediction under the UAE's agro-environmental conditions. Rising temperatures and water stress under medium–high emission scenarios (4.5–7.0–8.5) emerged as critical abiotic stressors, reducing wheat-yields up to half and maize-yields up to 75 %, and driving premature wheat and potato crop failure, particularly during the last two decades of the century. Leveraging APSIM-model for irrigation recommendations proved effective in ensuring maize efficient water-use, whereas it helps supporting appropriate potato scheduling across high-emissions scenarios. Findings highlighted the importance of investing in stress-tolerant crops and adapted varieties (e.g., C4 crops), alongside implementing UAE-specific soil–water management and climate-smart practices.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Achraf Mamassi) 23 Sep 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05273505v1
-
[hal-05301393] Développer des indicateurs de comptabilité environnementale pour gérer la santé des cultures et des agroécosystèmes
[...]
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Aude Barbottin) 07 Oct 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05301393v1
-
[hal-05263238] Assessing sustainability and resilience of three dairy value chaines in Southern Mediterrenean countries
[...]
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Francesco Accatino) 16 Sep 2025
https://hal.science/hal-05263238v1
-
[hal-05282411] Comment les machines ont pris la terre
L'agriculture numérique – drones, tracteurs connectés, pulvérisateurs de « précision », etc. – est aujourd'hui présentée comme une solution incontournable pour affronter les défis alimentaires et écologiques globaux. Ce projet s'inscrit dans la continuité des politiques d'équipement agricole ayant favorisé la concentration des exploitations et l'intensification des modes de production depuis les années 1950. Les machines agricoles demeurent toutefois des technologies peu débattues et peu étudiées. Quelles sont les organisations économiques et professionnelles ainsi que les politiques publiques qui, hier comme aujourd'hui, promeuvent des technologies intensives en capitaux et gourmandes en énergies fossiles ? Quelles transformations du travail agricole et quelles conséquences environnementales en résultent ? Rassemblant les contributions d'historiens et d'historiennes, de sociologues et d'anthropologues, ce livre éclaire les formes des verrouillages sociotechniques dans lesquels sont pris les agriculteurs et les agricultrices, contraignant leurs choix, augmentant leur empreinte environnementale, limitant la maîtrise de leurs outils de travail, et décourageant leurs velléités de bifurcation.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Sara Angeli Aguiton) 25 Sep 2025
https://edf.hal.science/hal-05282411v1
-
[hal-05266907] Assessing the vulnerability of French livestock production to climate and socio-economic change
Climate change poses challenges to French livestock sector, but existing knowledge about its impacts and adaptation strategies vary according to livestock farming systems and regions. The aim of this study is to analyse how climatic and socio-economic changes affect French livestock farming and how these effects vary according to geographical contexts, animal species (ruminant and monogastric) and systems (e.g., pasture-based or landless). To answer this, the study relies on grey literature, including project reports, and expert opinions, which provide insights from those most familiar with regional conditions. A dynamic tracking method was used to cover diverse farming systems and all metropolitan French regions. In addition, 15 semi-structured interviews were conducted with experts, such as veterinarians, agricultural advisors, project managers and researchers, selected for their contributions to relevant projects and expertise in livestock farming and climate change adaptation. The data were organized in a grid of analysis that categorises impacts based on their typology, the climate-related stressors causing them and the sectors affected (e.g., animal feed, livestock performance, and water and soil resources), to compare results across regions and livestock systems. Preliminary results show that heat stress is a common problem in all regions: 77% of the surveyed sources indicated negative impacts on animal welfare and productivity. However, other issues, such as emerging diseases, appear more region- and sector-specific (5% of sources). A literature gap was identified regarding the impact of climate change on monogastric livestock production in the French regions, as most studies focus on ruminant systems. This study offers a comprehensive overview of the challenges climate change poses to the French livestock sector and shows how these challenges vary by region. It provides a territorial perspective focusing on animal species, farming systems and stages of the production chain. It provides a base for future discussions between value chain actors on the impact of climate change on livestock farming.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Laurine Coré--Brazier) 18 Sep 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05266907v1
-
[hal-05273229] Pourquoi ne parvient-on pas à réduire l’usage des pesticides ?
Présentation "pourquoi ne parvient-on pas à réduire l'usage des pesticides?"' au laboratoire de Sophia Antipolis de l'ANSES, sur la base des résultats des projets BECREATIVE et INTERLUDE
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Muriel Valantin-Morison) 25 Sep 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05273229v2
-
[hal-05249454] Analyse des successions culturales 2015 -2022 en France : état des lieux du niveau de diversification en agriculture conventionnelle et biologique
L'allongement et la diversification des rotations sont des leviers majeurs pour réduire le recours aux produits phytosanitaires et engrais de synthèse. Face à ces enjeux, il est nécessaire d'acquérir des connaissances sur les successions culturales à échelle géographique fine. A partir des données de séquences de cultures issues du Registre Parcellaire Graphique, et du travail d'un groupe d'experts en agronomie, l'Observatoire du Développement Rural a précédemment produit un jeu d'indicateurs qualifiant les successions sur terres arables, sur la période 2015-2021. Une nouvelle version de ces indicateurs, portant sur 2015-2022, est à présent disponible. Les résultats distinguent désormais les successions en agriculture biologique et conventionnelle. En moyenne, 3.7 cultures sont enregistrées sur 8 années de succession. Les successions sont plus diversifiées en agriculture biologique et comportent beaucoup plus fréquemment des légumineuses. Sur les quatre dernières années de la période, près de 90 % des surfaces ont eu au moins deux cultures différentes, ce qui correspond à la nouvelle norme relative aux rotations introduite dans la PAC 2023-2027.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Marie-Sophie Dedieu) 11 Sep 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05249454v1
-
[hal-05308573] Agroecological engagement among beginning livestock farmers’ farms in France: a marginal but emerging trend
Introduction: Livestock production is undergoing major transformation as it confronts environmental, economic, and social challenges. This study uses statistical analysis of the 2020 French agricultural census to examine the extent to which beginning livestock farmers' farms contribute to the agroecological transition of livestock farming systems. Methods: Utilizing data from the 2020 French Agricultural Census and the Mutualité Sociale Agricole database, we identified farms where at least one farmer obtaine official status as a farm manager between 2010 and 2020 (beginning farmers' farms [BFF]) and compared them with earlier farmers' farms (EFF). We characterized these farms based on structural, functional, and sociodemographic variables, emphasizing indicators of agroecological functioning. Through multiple factor analysis and hierarchical clustering, we developed a BFF typology across production orientations. Results: Results indicated three to six clusters per production orientation, grouped into four transversal farm types: type A, large-scale farms with limited participation in quality schemes; type B, medium-scale farms with high participation in quality or origin certifications and strong reliance on permanent grassland; type C, small-scale farms with organic certification and short supply chains; and type D, crop-based farms with secondary livestock activities. BFF exhibited greater diversity and more significant engagement in agroecological practices than EFF, particularly through type C farms, which emphasize organic production and short-value chains. BFF comprised a slightly larger share of type C farms than EFF, suggesting a modest shift toward agroecology. However, the majority of beginning livestock farmers still start their careers on type A farms (except for goat farming), which are larger and less engaged in quality schemes, suggesting that the overall transition to agroecological systems is still in its early stages. Type B and C farms represent relatively larger clusters among beginning farmers' farms than among others, suggesting a possible shift toward more agroecological farming. Discussion: These findings underscore both the persistence of structural trends in agricultural transformation and the challenges beginning farmers face in adopting agroecological practices. Facilitating access to production resources, promoting good working conditions, and ensuring fair incomes while preserving the environment should be priorities for agricultural extension services and public policies supporting these transitions.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Lisa Vincent) 10 Oct 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05308573v1
-
[hal-05253839] Measuring city relationship strength beyond total counts: A multidimensional framework for distinguishing prominence from interdependence and significance
Relying on counting the number of interactions to gauge city relationship strength can be misleading, as volumes often only reflect the prominence of large cities rather than city interdependence. Drawing on statistical concepts of effect size and confidence, this study develops a relationship classification framework that identifies interdependent and statistically significant relationships. For demonstration, this framework is applied to placename co-occurrences in English Wikipedia articles for 100 European cities. Each city relationship is evaluated through five metrics: co-occurrence, mutual information, statistical confidence, a combined mutual information–confidence metric and a relative gravity model. The findings demonstrate that a high co-occurrence, commonly observed between large cities like London and Paris, typically corresponds with high statistical confidence, but does not necessarily imply strong interdependence. By contrast, strongly interdependent relationships tend to be regionally clustered, such as the Dutch Randstad (Amsterdam–Rotterdam–The Hague), the Flemish Diamond (Brussels–Antwerp–Gent) and the Ruhr region (Dusseldorf–Essen–Duisburg). By differentiating relationship types, this framework reveals the complexity of intercity relationships and regional patterns that conventional methods fail to capture, offering a more nuanced understanding of city networks.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Wang Tongjing) 15 Sep 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05253839v1
-
[hal-05242439] Uncovering the diversity of farmers' practices to organise the redesign of a crisis-stricken sector: the case of French cherries
How can we prioritize what needs to be redesigned in an agricultural sector in crisis? The French cherry sector has been facing this question since the arrival of an invasive pest Drosophila suzukii (DS), in 2010. The economic, environmental, and social impacts associated with managing this pest (mental burden, intensive use of pesticide, economic loss, etc.) are jeopardizing the short-term future of the sector. This 'emergency situation' sparks controversies around the management strategies to prioritize (e.g., pesticide use exemptions vs. redesign) as the national and regional players involved in the management of DS lack knowledge of the current farmers' practices and the concrete problems they face in their day-to-day work. While extensive research has focused on the biology of DS, this study aims to uncover the diversity of farmers' cherry practices to bring reflexivity to collectively discuss priorities for redesigning the sociotechnical cherry system, considering emergencies. The study highlights different farmers' flies management logics and ways to address the DS issue in different situations (e.g. a highly diversified farm on a plain vs. a specialised farm on slopes). It also shed light on situated problems encountered by farmers when managing DS (e.g. work organisation, ethical issues, investment), which contrasts with the way in which national players tackle this issue. These results aim to be used in a near future to support the redesign of the sector, considering emergencies, in different design spaces involving actors engaged in the management of DS. Our results also contribute to the development of methods to support collective reflexivity in design processes in emergency situations.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Hugo Bourgez) 05 Sep 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05242439v1
-
[hal-05263694] Analysis of situations of use to design tools to help change practices
To help farmers change their practices, a growing number of tools are being offered to them and their advisers. One of the challenges is to design these tools so that they effectively and efficiently support those wishing to transform their practices. To meet this challenge, we use an approach based on an analysis of the activity that the tool to be designed should help to change. This analysis highlights the 'mediations' that the tool can support between an actor and the object of their action. Based on three completed projects (APPI'N, MoCoRiBa, DeciFlorSys), we demonstrate the impact of this approach on the design process, in terms of: (i) the properties of the tool to be designed and the mediations it supports; (ii) the forms of user involvement; and (iii) the design activity itself.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Marianne Cerf) 16 Sep 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05263694v1
-
[hal-05114020] Testing a low-complexity spatially distributed model to simulate the intra-annual dynamics of soil erosion and sediment delivery
[...]
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Francis Matthews) 16 Jun 2025
https://hal.science/hal-05114020v1
-
[hal-05257591] The decline of climate skepticism in France: An analysis of climate change attitudes over the last two decades
This article analyzes the evolution of public attitudes toward climate change in France. In the context of a challenging economic environment, the climate crisis continues to be a significant concern for the French populace, a concern that is exacerbated by the increasing frequency of climate-related disasters globally. Utilizing a logit model applied to four waves of a longitudinal survey conducted in 2000, 2010, 2019, and 2021, our findings indicate a noteworthy decline in climate skepticism. This reduction is correlated with an enhanced recognition of the scientific consensus on climate change and a broader adoption of environmentally responsible behaviors. Our analysis reveals significant associations between political orientation and climate skepticism: individuals who voted for far-right parties demonstrate a higher propensity for skepticism, whereas those who supported environmentalist parties exhibit a lower likelihood of skepticism. These findings highlight the critical need for ongoing efforts to communicate climate science effectively, promote pro-environmental behaviors, and acknowledge the pivotal role of political actors in mitigating climate skepticism.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Sébastien Bourdin) 23 Jan 2026
https://hal.inrae.fr/hal-05257591v1
-
[hal-05230396] PHYTOS-EXPLORER: SUPPORTING DATA-DRIVEN DECISION-MAKING TO REDUCE PESTICIDE USE AT THE TERRITORIAL SCALE
Monitoring pesticide use at the territorial scale is imperative for evaluating environmental policies, guiding local action plans, and mitigating risks to ecosystems, human health, and biodiversity. However, the scarcity of fine-scale data on pesticide applications poses a significant challenge in this regard. The Phytos-Explorer tool has been developed for the purpose of spatially disaggregating pesticide sales data and combining it with high-resolution land use information, approved product uses, and local expertise. The tool utilises a range of data sources, including national pesticide sales records (BNVD), agricultural parcel data (LPIS), and geographical land cover datasets, to allocate pesticide use estimates to particular crops and landscapes. This process is then validated through the application of expert knowledge and case studies. The application of the model across four contrasting territories demonstrated its ability to capture inter-annual trends, substitution dynamics, and crop-specific usage patterns. The validation process against ground-truth data demonstrated the efficacy of fungicides, herbicides, and growth regulators, with the performance of insecticides being comparatively lower. The findings of the study demonstrate the importance of incorporating local expertise in order to enhance the accuracy of the results. Whilst the present limitations encompass reporting delays and uncertainties associated with on-farm stockpiling, Phytos-Explorer evinces considerable potential to facilitate evidence-based decision-making for farmers, land managers and policymakers by enabling targeted interventions and tracking progress towards pesticide reduction.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Marco Carozzi) 29 Aug 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05230396v1
-
[hal-05232374] A systemic analysis of barriers to pesticide reduction at the farm level
As elsewhere in the world, pesticide reduction is not achieved in France (Hossard et al., 2017) despite an ambitious public policy aiming to foster practice change on commercial farms (the Ecophyto plan). Most of the studies analyzing obstacles to pesticide reduction at the farm level compile generic lists of factors hindering change without showing how these factors interact with one another, or how they relate to farmers' practices and their agricultural context (e.g. Bjørnåvold et al., 2022; Darnhofer et al., 2005). Indeed, these studies mainly emphasize generic constraints linked to the characteristics of alternatives (e.g., their limited availability, low effectiveness, or high labor requirements) or to farmers' motivations and attitudes towards agroecological transitions, but they rarely investigate how farmers’ practices choice, and the agronomic functioning of their cropping systems may impede pesticide reduction. The aim of our study was to explore farmer’s practices and their rationale, in order to decipher the farmer’s logic of pesticide use and unuse. Methodology Within the DEPHY-Farm network (a national farmer network enhanced to develop alternative practices to pesticide use), we selected farmers who showed contrasted trajectories of their Treatment Frequency Index (TFI) across years since their entry in the network (increase, reduction or stability at a high level, Table 1). We conducted interviews with 25 farmers in four different regions in France, in order to understand farmer’s practices and the rationale behind them. For each farmer, we produced a narrative using the action logic framework (Quinio et al., 2022; Salembier, 2019) to organize the systemic links established by the farmer during the interview between his/her practices, the interpretation he makes about agronomic processes at play, the information he uses to manage his crops, his satisfaction criteria, and contextual elements. By comparing the logics of farmers with different TFI trajectories, and drawing on agronomic literature, we identified, through the action logics, key systemic mechanisms explaining the high dependency on pesticides, thus depicting a systemic analysis of the obstacles to pesticide reduction on farms. We found that obstacles mentioned by the interviewed farmers varied from one farm to another, and an obstacle for one farm may not be an obstacle for another farm. Most often, obstacles are not related to a particular practice or pest, but are closely interlinked with the way farmers design their cropping systems. For instance, one farmer who prioritizes yield as a satisfaction criterion chooses a late-maturing corn variety and opts for early sowing to extend the crop cycle and therefore maximize yield. He systematically applies an insecticide while sowing the crop, as he reports high wireworm pressure in his plots, which could lead to significant yield losses (obstacle to pesticide reduction). Corn frequently returns in the crop rotation on irrigated plots, as it is considered the most profitable crop by the farmer, who has invested in a corn drying unit that needs to be cost-effective. As a result, he cultivates a large area of corn every year, which make it more difficult to shift sowing dates. By contrast, his neighbor, who had a similar rationale in the past, decided to reduce his corn acreage and to introduce other crops in order to break the cycle of weeds and pests while also spreading the economic risk associated with a single crop. He now selects an early-maturing variety that can be sown later, allowing the crop to establish under conditions where corn is more vigorous and quickly becomes less vulnerable to wireworm attacks. As a result, he applies no insecticides on his corn crops and is satisfied with this cropping system, as it helps reduce input costs (irrigation, pesticides, drying costs). However, he mentions that this logic is more suitable on relatively small farms like his, as a delay in sowing dates is easier for a small maize acreage. In contrast, farmers with large maize areas often need to start sowing as soon as possible, as the operation is spread over a longer period. This example show that pest pressure and pesticide use depend on farmer’s combination of practice (here crop rotation, crop variety and sowing dates), driven by specific satisfaction criteria and contextual elements (here farm size and specialized equipment). Using a cross-analysis of farmer’s action logics, we identified several systemic mechanisms that hinder pesticide reduction at the farm level in arable systems, among which “system simplification to reduce workload” and “cash crops oriented diversification”. We identify two key methodological contribution of this work. First, we used an in-depth analysis of the action logics of farmers who have reduced their TFI to put into perspective the logics of those who have not. In doing so, rather than identifying a list of generic obstacles, we unraveled strongly interlinked mechanisms at the farm level, which alert on certain trends in the agricultural sector (among which the increase of farm size and over-equipment of farms with cutting-edge equipment not well suited to system redesign). Moreover, the action logic framework so far has been used to highlight innovative agroecological practices, through innovation tracking for instance (e.g. Verret et al., 2020). In this study, we used the same concept to highlight systemic barriers to pesticide reduction at the farm level. A possible extension of this work would be to assess whether this systemic analysis could help farmers, agricultural advisors, researchers or other stakeholders to overcome the identified obstacles and design new strategies to support pesticide cut in arable systems.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Emma Le Merlus) 01 Sep 2025
https://hal.science/hal-05232374v1
-
[hal-05230402] PHYTOS-EXPLORER: supporting data-driven decisionmaking to reduce pesticide use at the territorial scale Session: Farming Practice Diversity in Agroecological Transitions: From Typologies to Analytical Tools
Monitoring pesticide use at the territorial scale is imperative for evaluating environmental policies, guiding local action plans, and mitigating risks to ecosystems, human health, and biodiversity. However, the scarcity of fine-scale data on pesticide applications poses a significant challenge in this regard. The Phytos-Explorer tool has been developed for the purpose of spatially disaggregating pesticide sales data and combining it with high-resolution land use information, approved product uses, and local expertise. The tool utilises a range of data sources, including national pesticide sales records (BNVD), agricultural parcel data (LPIS), and geographical land cover datasets, to allocate pesticide use estimates to particular crops and landscapes. This process is then validated through the application of expert knowledge and case studies. The application of the model across four contrasting territories demonstrated its ability to capture inter-annual trends, substitution dynamics, and crop-specific usage patterns. The validation process against ground-truth data demonstrated the efficacy of fungicides, herbicides, and growth regulators, with the performance of insecticides being comparatively lower. The findings of the study demonstrate the importance of incorporating local expertise in order to enhance the accuracy of the results. Whilst the present limitations encompass reporting delays and uncertainties associated with on-farm stockpiling, Phytos-Explorer evinces considerable potential to facilitate evidence-based decision-making for farmers, land managers and policymakers by enabling targeted interventions and tracking progress towards pesticide reduction.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Marco Carozzi) 29 Aug 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05230402v1
-
[hal-05421087] Study of the Factors Hindering the Adoption of Variable-rate Application Systems in Northern France
[...]
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Marco Medici) 17 Dec 2025
https://hal.science/hal-05421087v1
-
[hal-05269510] Designing Pesticide-Free Agriculture: A Territorial Research Framework to move from Theory to Practice
[...]
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Muriel Valantin-Morison) 19 Sep 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05269510v1
-
[hal-05238188] Understanding and supporting a territory's transition towards zero pesticide use: the case of the western plain of Montpellier. Co-designing agrifood systems across scales: methods and tools for multi-actor approaches
[...]
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Myrto Parmantier) 03 Sep 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05238188v1
-
[hal-05251440] Flexible crop rotation identification and classification: New tool and application to France
Flexible crop rotation identification and classification: New tool and application to France.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Ugo Javourez) 15 Sep 2025
https://hal.science/hal-05251440v1
-
[hal-05294699] Reconciling sustainability and sovereignty? There is no relationship between nutritional quality, environmental impact and food sovereignty in the French dietary pattern
Background and objectives: The capacity to provide sustainable diets, covering nutrient requirements, reducing risk of chronic disease and having a low impact on the environment, depends on domestic agricultural production and agricultural commodity trade flows. The transition to more sustainable food systems is therefore closely linked to food sovereignty issues. This study aimed to analyze the nature of the relationships among the nutritional, environmental and food sovereignty dimensions of food groups within the current French food supply. Methods: The dietary pattern was estimated using the food repertory from the latest French representative survey of adult food consumption, INCA3 (n = 2,121). For each food item (n = 1,772), indicators related to the three dimensions were calculated. First, we developed a nutrient-based food scoring system (PANFood, inspired by the PANDiet system) to assess nutritional quality based on the potential to provide sufficient indispensable nutrients without excessive nutrients to limit (n=32), using the CIQUAL database. Second, environmental impact was estimated using the single Environmental Footprint (EF) score from the Agribalyse database. In addition, a sustainability score was calculated by normalizing and standardizing these two indicators to create a more synthetic score. Third, food sovereignty was estimated as the food self-sufficiency (FSS) capacity, calculated as the ratio of domestic production to food availability using international (FAOSTAT) and national databases. Finally, these indicators were calculated for each food group as the consumption-weighted average of the food indicators to analyze their distribution across the dimensions. The long-term health value of food categories, as outlined in the Global Burden of Disease study, was also considered in the analysis. Results: There was no significant correlation between self-sufficiency and nutritional or environmental dimensions. Nevertheless, certain patterns were observed. The cereals and tubers achieved a favorable sustainability profile and a strong self-sufficiency. Dairy products presented a high self-sufficiency capacity, but their overall sustainability profile was moderate. Fruits, vegetables, and legumes demonstrated favorable sustainability profiles, with low cardiovascular disease risk, but their self-sufficiency capacities were not adequate and varied within the groups (e.g., low for citrus and high for apples). Finally, the Meat group exhibited a poor sustainability profile achieving the highest environmental impact and moderate self-sufficiency capacity overall. However, there were notable discrepancies between the type of products and the species (e.g., red meat and poultry). Conclusions: In France, based on the current dietary pattern, food sovereignty does not align with these sustainability dimensions. However, certain food groups can serve as lever to enhance sovereignty. These data could be used to model more sustainable and self-sufficient diets.
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Marianne Cerf) 02 Oct 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05294699v1
-
[hal-05246569] Systems approach and design in agronomy: past, present and future
[...]
ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Jean-Marc Meynard) 09 Sep 2025
https://hal.inrae.fr/hal-05246569v1